 |
|
| Une rubrique qui vous invite à découvrir la vie de personnages célèbres ou méconnus ayant marqué l'Histoire de Paris : notes biographiques pour se plonger dans la vie et l'oeuvre de personnalités marquantes de la capitale. |
| ||||
Il n'y a plus qu'un Parisien, – depuis le docteur Véron et après M. Auber, bien entendu, – c'est le Persan. Les autres sont dépaysés par M. Haussmann, et ils attendent que l'univers, qui se croit aux Porcherons sur le boulevard, ait fini son sabbat.
Nos Parisiens, pour le moment, sont des Turcs, des Boyards, des Fédéraux, des Valaques, des Polonais, des Madgyars, des Mexicains et des marchands de cigares de la Havane. Sondez les baignoires, feuilletez le Betting-Book, soupez chez Verdier, pariez rue Royale, achetez au Tattersall, aimez rue Saint-Georges, dites-nous qui jette des fleurs à la Patti ; qui est-ce qui se ruine, qui brise la vaisselle, qui est-ce qui se grise, qui aime nos femmes et entretient nos danseuses ; qui est-ce qui donne des coups d'épée et qui en reçoit ? C'est le Caire, c'est Pétersbourg, c'est Londres, c'est Vienne, c'est Bombay, c'est Cuba, c'est Stamboul et c'est Lima ! – Mais ce n'est pas Paris et vous l'allez bien voir.
Le prince Nariskhine régale nos danseuses, Khalil-Bey tenait la banque
hier, le comte Branitski crie « Banco ! » Mustapha-Pacha rédige
nos journaux. La princesse de Metternich invente nos chapeaux et décrète
nos jupes que Worth 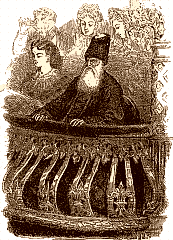 exécute, M. Mackensie-Grieves nous donne le départ,
M. Mikous fait nos ballets, Verdi, Offenbach, Ricci et Poniatowski font nos
opéras. Strauss conduit notre orchestre, Bischoffsheim construit nos
salles de spectacle, Hottinguer escompte nos billets, Rothschild nous paye
nos dividendes, John Arthur nous loge, Imoda nous rafraîchit, Kcherkoff
nous habille.
exécute, M. Mackensie-Grieves nous donne le départ,
M. Mikous fait nos ballets, Verdi, Offenbach, Ricci et Poniatowski font nos
opéras. Strauss conduit notre orchestre, Bischoffsheim construit nos
salles de spectacle, Hottinguer escompte nos billets, Rothschild nous paye
nos dividendes, John Arthur nous loge, Imoda nous rafraîchit, Kcherkoff
nous habille.
C'est complet !
Le Parisien est débordé, il se trouble, il chancelle et se dérobe en rasant les murs. Seul, le Persan garde son flegme inaltérable, il est depuis vingt-cinq ans l'assidu des boulevards, il garde imperturbablement la même stalle à l'Opéra et aux Italiens. Paris s'en va, le Persan reste, et de tous nos types si nombreux autrefois, c'est le seul qui nous soit resté fidèle.
Et cependant, ce Persan reste une énigme, c'est de toutes celles qui circulent sur le pavé de Paris, la plus obscure, la plus acharnée, et la plus conséquente. Cet Asiatique est un sphinx, on peut l'observer, on ne le pénètre point.
Il apparut, il y a plus de vingt-cinq ans, aux yeux des Parisiens étonnés, vêtu comme hier et comme demain, aussi vieux déjà, aussi soigné, lustré, poli. Tel il était alors, tel il est aujourd'hui. Il porte un haut bonnet d'astrakan terminé par une petite houppe en soie blanche, bonnet qu'il n'a jamais ôté en public, qui lui couvre les oreilles et descend jusqu'aux sourcils. Sa barbe, qui pousse sur les pommettes et s'attache sous les yeux, est blanche comme la soie floche et soyeuse comme elle. Ses yeux sont vifs au fond de l'arcade dominée par un épais sourcil blanc, ses lèvres sont fermées. Sa grande batta noire, qui descend jusqu'aux pieds, est du drap le plus fin ; son pantalon, à l'européenne, est d'un bleu clair, il porte sous sa robe un large cachemire et tient constamment ses deux mains croisées sur sa poitrine, cachées dans ses larges manches comme dans un manchon. Son pied est imperceptible, sa main est osseuse et très soignée. Il est doux, silencieux, sa mélancolie ressemble à de la résignation ; on a vu pendant cinq ou six années le pauvre Scudo, son voisin de stalle, apostropher les chefs d'orchestre au nom de Cima-rosa et de Mozart, et gesticuler comme un furieux à son côté, sans qu'il parût s'émouvoir de ce singulier voisinage.
Il est devenu légendaire et il nous manquerait s'il n'occupait pas sa stalle. Depuis plus de vingt ans, tous les soirs, automatiquement, il entre à l'Opéra, à l'Opéra-Comique ou aux Italiens. – Il est beaucoup moins assidu depuis quelques années au second théâtre. Il frôle les murs et se dissimule, tend la main à l'ouvreuse, prend la lorgnette, s'assied sans mot dire et ne lève pas une fois les yeux depuis le premier acte jusqu'au dernier. Qu'on applaudisse à outrance, que la salle éclate, que l'enthousiasme déborde, il reste inébranlable. Les bouquets pleuvent, la diva monte aux étoiles, le sphinx persan caresse sa chimère sans prendre souci de ces clameurs. Souvent ses yeux se ferment pendant tout un acte, les bravos le réveillent et il n'en éprouve aucun embarras. Si le sommeil le sollicite encore, il referme les yeux et dort comme un enfant. Il a le sommeil paisible, profond et presque majestueux. On rirait à nous voir fermer les yeux à la Patti, mais lui tient si peu de place, et fait si peu de bruit ! – Je dois même dire que son sommeil a plus de caractère que sa lucidité, quand ses yeux se rouvrent à la lumière, il semble triste, désappointé, et il échappe bientôt à cet état d'oppression par un nouveau sommeil.
Quelquefois il a soif, il fait un signe et manifeste son désir, l'ouvreuse comprend et apporte un sorbet. Le prince Ismaël fouille dans sa gandourah, en sort un petit étui de velours vert, y prend une cuiller d'or qu'il essuie délicatement après s'en être servi, et reprend son attitude résignée.
Méry jurait ses grands dieux qu'il le connaissait beaucoup, et lorsque j'écrivis les Célébrités de la rue, je lui passai ma plume pour peindre le Persan. L'auteur de la Guerre du Nizam, avec son incroyable imagination, fit un Persan de fantaisie, plus curieux peut-être que celui que j'esquisse aujourd'hui. Méry le faisait naître à Amazia, l'appelait Abbas-Mirza sur la foi de je ne sais quel état civil, et quand on le poussait un peu, le poète assurait que le prince descendait du grand roi du Pont. Ce qui est certain, c'est qu'un jour, en entendant Maubant scander de sa belle voix mordante ces deux vers de Mithridate :
Doutez-vous que 1'Euxin ne me porte, en deux jours,
Aux lieux où le
Danube y vient finir son cours ?
le prince Ismaël éclata de rire et expliqua à M. Viennet, son immortel voisin, que Mithridate faisait une grosse faute de géographie et devançait le fil électrique en parlant de se rendre de Sinope à Varna en deux jours, puisque aujourd'hui il en faut sept avec le paquebot pour exécuter le trajet. – C'est la dernière fois que le Persan a parlé en public.
M. Garcin de Tassy lui a demandé un jour dans la langue qu'il professe, pourquoi il allait ainsi tout de noir vêtu. Ismaël a répondu en citant un vers d'Horace. Il parle latin, il écrit chez M. Buloz et il a traduit le poème d'Azz-Eddin-El-Mocadessi, les Oiseaux et les fleurs, outré de voir qu'un savant orientaliste, en faisant passer ce poème du persan au français, en avait ôté les fleurs et empaillé les oiseaux. – Donc le Persan est un lettré.
Lors de l'arrivée de la légation persane en 1857, la subite disparition du prince Ismaël sembla donner créance à des bruits vagues dont les Parisiens curieux s'étaient faits l'écho, mais le Persan était à Londres et ne fuyait pas Ferruk-Khan. Cet Asiatique est un sphinx, un pylône, une inscription cunéiforme, un indéchiffrable hiéroglyphe ; on peut peut-être assurer, – je dis peut-être, – qu'il a voulu, dix ans avant M. de Lesseps, lui faire concurrence et poser un trait d'union entre la mer Caspienne et la mer d'Azof, ce qui dérangeait sensiblement les plans des Anglais et l'a forcé de quitter Ispahan pour vivre dans l'exil.
Son utopie, – si c'en est une, – vaut la peine d'être définie. Je la crois authentique.
Constituez une société, appelez prodigieusement de capitaux et descendez vers le quarante-huitième degré de latitude, à l'endroit où le Don, descendant dans la mer d'Azof, fait un coude et semble, sur la carte, s'unir au Volga qui, lui, descend à la mer Caspienne. Appelez beaucoup de fellahs ou, – si vous y êtes, – convoquez l'ingénieur Borel avec ses dragues, et au bout d'un mois les paquebots russes sortis de la mer Noire et des Palus-Méotides remonteront le Don, traverseront le petit canal et descendront à la mer Caspienne par la plus large embouchure du Volga. – Ce n'est pas tout : appelez encore une fois le même ingénieur ; creusez un autre canal depuis les bords de cette petite Méditerranée jusqu'à Téhéran, – je pense que vous me suivez sur la carte, – creusez encore de Téhéran à Schouster : vous êtes aux Indes et les Anglais sont furieux.
Est-ce pratique, ne l'est-ce point ? Est-ce encore Méry qui a fait courir ce bruit-là ? c'est possible, mais il fallait l'enregistrer.
Au point de vue de sa vie de chaque jour, on sait que le prince est ostensiblement d'une douceur parfaite, qu'il habite rue de Rivoli, en face des Tuileries ; il a un coupé admirablement tenu pour l'hiver, une victoria pour l'été, un secrétaire anglais et un valet qui n'entre jamais dans sa chambre à coucher. Il. n'a point été insensible, mais comme un célèbre compositeur de ce temps-ci, il y a longtemps qu'il ne se mouche plus : c'est un simple commissionnaire en velours bleu qui était, en des temps plus ardents, chargé de distribuer ses foulards – on les payait en prince.
Les voitures lui appartiennent, les chevaux sont loués, et sa cuisine vient de chez le traiteur. Il se lève entre dix et onze heures, et se couche en revenant du théâtre. Son valet de chambre est Suisse ; il l'a depuis treize ans à son service. Ce valet n'entre jamais dans sa chambre à coucher. Tous les jours, de deux heures et demie à cinq heures, le mystérieux personnage se rend en voiture au bois ou au parc Monceaux, blotti dans le fond de son coupé et ne semblant prendre aucun intérêt à ce qui l'entoure. En revenant du bois, il entre chez Jauret, le marchand de comestibles de la rue Saint-Honoré, et, là, choisit lui-même ses fruits et ses primeurs. Il ne marchande jamais et passe pour n'avoir jamais changé de fournisseurs depuis qu'il est à Paris.
Depuis vingt-six ans, le Persan habite le même appartement, rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries, et jamais il n'y reçoit personne. Le plus curieux de tous les détails que j'ai recueillis, celui qui prouve le mieux jusqu'à quel point ce singulier étranger a renoncé au mouvement et à la vie, c'est qu'il supprime le fatalisme en n'ouvrant jamais une seule des lettres qu'on lui adresse ; il ne permet pas aux événements de peser sur sa vie. Son valet de chambre, ou même son concierge, lit tout ce qui arrive à son nom et a mission de brûler sans même faire un rapport.
Il n'a eu dans sa longue existence parisienne qu'un moment d'attendrissement et qu'une sympathie spontanée ; ce fut à l'égard de la buraliste de la location du grand Opéra. Cette honorable personne, ancienne pensionnaire de Ham, qui faisait passer des lettres dans du pain au lait à celui qui devait être un jour l'empereur Napoléon III, était parvenue à dérider le mélancolique vieillard, et celui-ci, dans un moment d'expansion, tira sa tabatière de sa poche et la lui offrit. La buraliste s'en fut chez le changeur du coin et voulut lui confier le souvenir en échange de quelques louis. - Le bijou était en cuivre.
Il parle par monosyllabes, supprime les articles comme dans une dépêche télégraphique, s'exprime dans un certain français et a écrit, longtemps avant M. de Sartiges, des Scènes de la cour de Téhéran à la Revue des Deux Mondes. Il reçoit le Quaterly Review, le Frazer Magazine, le Times et quelques journaux extraordinaires publiés en Asie. Quant aux journaux français, il ne les lit jamais, mais il reçoit les dépêches télégraphiques sur le papier bleu de l'agence Havas, et tous les ans, vers le 8 janvier, il se présente, à la galerie d'Orléans, chez Dentu, et demande d'un air mélancolique l'Annuaire du bureau des longitudes. - Le reste est le secret de la chancellerie de Téhéran.
Dantan jeune, le célèbre sculpteur auquel on doit ce panthéon charivarique dans lequel figurent tous les hommes éminents de ce temps-ci, a sculpté naguère une sorte de bas-relief du balcon des Italiens, dans lequel le Persan occupe sa place habituelle. Voilà donc notre type à jamais classé.
|
|
:: HAUT DE PAGE :: ACCUEIL
| ||||