 |
|
| Cette rubrique vous livre les secrets de la vie quotidienne d'autrefois à Paris, consignant les activités des Parisiens d'antan, leurs habitudes, leurs occupations, leurs activités dont certaines ont aujourd'hui disparu. Pour mieux connaître le Paris d'autrefois dans sa quotidienneté. |
| ||||
En moins de deux ans, Louis XIV avait fait aplanir et planter d'arbres tous les boulevards, depuis la porte Saint-Antoine jusqu'à l'entrée de la rue Royale, où se trouvait la nouvelle porte Saint-Honoré. Mais le Cours, comme on appelait alors ce vaste terrain, était encore revêtu de murs sur toute sa longueur, et quoique cette promenade fût déjà chère aux Parisiens, elle semblait toujours être en dehors de la ville, comme le sont aujourd'hui les boulevards du midi.
Ce ne fut qu'à la fin du XVIIIe siècle, en l'année 1777, que l'on commença enfin à paver les boulevards, et à en combler les fossés, pour que des maisons pussent être élevées des deux côtés de la promenade. Dès lors, et en moins de dix ans, la solitude du Cours se métamorphosa en le quartier le plus peuplé, le plus riche, le plus brillant de tout Paris. Dès 1782 Mercier, dans son Tableau de Paris, place les boulevards à côté de tout ce qu'il y a de plus beau dans la capitale. « C'est, dit-il, une promenade vaste, magnifique, commode, ouverte à tous les états, infiniment peuplée de tout ce qui peut la rendre agréable et récréative. »
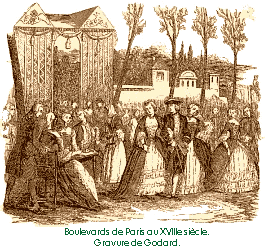 La belle société avait depuis longtemps abandonné le
quartier du Marais ; et la place Royale, si brillante au siècle précédent,
n'était plus peuplée que de bonnes d'enfants et de marchandes
de citrons. La vogue était alors aux Tuileries et surtout aux galeries
du Palais-Royal ; cependant les boulevards partageaient aussi la faveur de
la mode ; et quoiqu'ils fussent de bonne heure devenus trop bourgeois, cependant
ils attiraient encore la foule élégante par leur richesse, leurs
curiosités, leurs spectacles de toutes sortes.
La belle société avait depuis longtemps abandonné le
quartier du Marais ; et la place Royale, si brillante au siècle précédent,
n'était plus peuplée que de bonnes d'enfants et de marchandes
de citrons. La vogue était alors aux Tuileries et surtout aux galeries
du Palais-Royal ; cependant les boulevards partageaient aussi la faveur de
la mode ; et quoiqu'ils fussent de bonne heure devenus trop bourgeois, cependant
ils attiraient encore la foule élégante par leur richesse, leurs
curiosités, leurs spectacles de toutes sortes.
Les plus beaux magasins de modes, les plus brillants cafés, les académies de coëffure les plus renommées et les plus fastueuses se trouvaient aux boulevards. Tout le jour, les petits théâtres paradaient sur leur balcon ; et les moralistes du temps se plaignaient que ces farces fissent perdre aux ouvriers les heures les plus précieuses de la journée.
Un peu plus loin, devant la porte du sieur Curtius, s'égosillait sans relâche un crieur : « Entrez, entrez, messieurs, venez voir le grand couvert ; entrez, c'est tout comme à Versailles. » Curtius ne prenait que deux sols par personne, et, moyennant cette modique somme, il faisait voir, assise autour d'une grande table, toute la famille royale, escortée des ducs et pairs ; puis, dans la pièce voisine, se trouvaient moulées en cire les plus jolies femmes de Paris, les écrivains de renom, les voleurs fameux, enfin toutes les célébrités de l'époque. Et telle était la vogue dont jouissaient ces figures de cire, que le sieur Curtius gagnait plus de cent écus par jour, avec la montre de ces mannequins enluminés.
Mais ce qui mit surtout à la mode la promenade du boulevard, ce fut l'invention de l'artificier Torré : il avait imaginé de donner au public, pour son argent, deux fois par semaine, des feux d'artifice sur le boulevard du Temple. Les propriétaires des maisons voisines, effrayés de ces divertissements dangereux, intercédèrent auprès du minnistre de la police, pour qu'il défendît ces feux d'artifices.
Le sieur Torré, qui avait fait de grands frais d'établissement, se trouvant ainsi ruiné, eut recours à un expédient qui lui réussit : sur l'emplacement qu'il avait acheté, il éleva des salles de bal, fit construire des cafés, établit des boutiques de modes, et obtint la permission de réunir deux fois la semaine le public, de cinq à dix heures du soir ; le prix d'entrée était de trente sous. La nouveauté du spectacle, unie à l'intérêt qu'avaient inspiré les malheurs du pauvre artificier, donnèrent une vogue incroyable à ce nouvel établissement, que son propriétaire appela Vauxhall, quoiqu'il n'eût rien de commun avec le Vauxhall de Londres. Le Vauxhall de Torré trouva de nombreux imitateurs qui n'eurent point sa fortune ; le Colisée et la Redoute chinoise firent d'assez minces affaires, et se ruinèrent enfin.
Mais la physionomie de la foule élégante qui fréquentait les boulevards n'était pas moins curieuse que tous ces spectateurs, pas moins riche que toutes ces boutiques éblouissantes qui bordaient la promenade des deux côtés. La grande mode était alors aux bonnets à la Grenade, à la Thisbé, à la sultane, à la Corse ; toutes les femmes étaient coiffées en limaçon. Les hommes portaient des chapeaux blancs à la Boston, à la Philadelphie, à la Colin-Maillard. « Une rage de frisure, disait Mercier, a gagné tous les états : garçons de boutique, clercs de procureurs et de notaires, domestiques, cuisiniers, marmitons, tous versent à grands flots la poudre sur leur tête, tous y ajustent des bonnets pointus, des boucles étagées. L'odeur des essences et des poudres ambrées vous saisit chez le marchand du coin comme chez le petit-maître élégant et retapé. » Il n'y avait pas moins de douze cents perruquiers à Paris, employant plus de six mille garçons ; et les économistes du temps calculaient que la farine dépensée à poudrer les chevelures eût nourri dix mille pauvres par an.
La canne avait remplacé l'épée, et les femmes elles-mêmes, comme on peut le voir dans Mariage de Figaro, avaient repris la canne qu'elles portaient au onzième siècle ; elles sortaient seules, dans les rues et sur les boulevards, la canne à la main. La canne n'était pas, d'ailleurs, pour elles un pur ornement ; elles en avaient véritablement besoin plus que les hommes, « vu la bizarrerie de leurs hauts talons, qui ne les exhaussaient que pour leur ôter la faculté de marcher. »
En même temps, la folie des femmes pour les petits chiens était poussée jusqu'au dernier point. « Nos dames, dit un moraliste du temps, sont devenues gouvernantes de roquets, et partout on les voit suivies de grands imbéciles qui, pour leur faire la cour, portent leurs chiens publiquement sous le bras dans les promenades et dans les rues. »
Les hommes avaient bien aussi leurs petits ridicules particuliers. Les lorgneurs remplissaient les promenades et les spectacles ; et à force d'être commune, cette coutume ne passait plus pour indécente. A côté des lorgneurs devait être rangée une autre classe tout aussi impertinente, c'est-à-dire celle des physionomistes : la science de Lavater était à la mode, et chacun se piquait de lire sur le visage d'autrui ses pensées les plus secrètes. Ces prétendus philosophes se plantaient résolument au milieu des boulevards ou du Palais-Royal, et là s'appliquaient à dévisager tous les passants.
|
|
:: HAUT DE PAGE :: ACCUEIL
| ||||